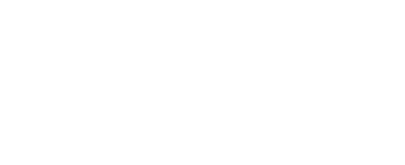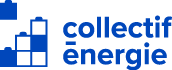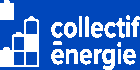« Il y a un modèle à trouver, un marché, mais qui n’est plus nécessairement uniquement celui qui était envisagé dans les années 80-90, à savoir la seule production d’électricité en base. Il faut que le nucléaire devienne compatible économiquement avec le système dans lequel il évolue », analyse Maxence Cordiez. En effet, la question du modèle économique du nucléaire est devenue centrale face aux bouleversements que connait le secteur de l’électricité.
En 2025, les notions de peakload et de baseload, auparavant fondamentales pour expliquer les variations des prix de l’énergie, n’ont plus autant de sens. Avec l’installation des renouvelables, l’émergence des batteries de stockage et le développement de l’autoconsommation, la consommation n’est plus aussi stable. Les prix sont désormais bas en milieu de journée. Les variations sont marquées sur des temps courts, en début de matinée et de soirée. La flexibilité gagne également du terrain et le système du merit order donne moins de marge au nucléaire. Certains clament déjà la mort de l’électricité baseload.
Pourtant, dans le même temps, l’intérêt pour le nucléaire est vif. Les deux premières parties de notre dossier l’ont démontré. Des pays misent à nouveau sur cette énergie, qui intéresse tant pour les services rendus, avec une production stable, prédictible, rassurante, que pour ses innovations et les nouveaux modèles de production proposés. Mais le nucléaire peut-il trouver une viabilité économique dans le nouveau fonctionnement des marchés de l’électricité ? Son rôle sera-t-il le même à l’avenir, alors que ses coûts de construction demeurent souvent rédhibitoire pour les investisseurs privés ?
Pour que le nucléaire se taille une part du marché de l’énergie, cela va devoir passer à la fois par une certaine maîtrise financière de son LCOE, pour être compétitive tout en devenant un soutien à des énergies émergentes comme le solaire et l’éolien, mais aussi par d’éventuels choix fiscaux pour inciter à la consommation d’électricité et soutenir l’usage de l’ensemble des énergies décarbonées. Ce choix stratégique nécessite une réflexion plus large sur les arbitrages économiques dans la consommation d’énergie.
Cet article fait partie d’un dossier plus complet sur l’avenir du nucléaire en France et dans le monde. La première partie s’intéressait aux différentes stratégies nationales. La deuxième partie s’intéressait aux innovations du secteur pour répondre aux besoins du système énergétique : petits réacteurs, nouveaux combustibles, modèles flexibles…
Quels sont les avantages économiques du nouveau nucléaire ?
Le coût du nucléaire dépend en majeure partie de sa construction, un investissement qui se compte en milliards d’euros. Xavier Ursat, dans un entretien avec Capgemini, précise : « C’est notre véritable enjeu [alors qu’EDF] est en train de finaliser le coût et le planning qui va servir à fonder la décision d’investissement » pour les EPR2.
Selon les calculs d’Ey-Parthenon, ce montant sera particulièrement élevé dans les cinq ans à venir, avant de décroître sur les deux décennies suivantes. Ainsi, l’investissement annuel mondial plafonnerait jusqu’à 159 milliards de dollars par an, pour ensuite atteindre environ 76 milliards en 2050, en étant fléché presque intégralement vers la construction.
Néanmoins, la filière peut faire valoir des coûts moindres pour l’ensemble du système électrique. Le nucléaire réduit les besoins de flexibilité et de gestion du réseau, puisqu’il fournit une énergie de base centralisée. Son électricité est plus simple à coordonner en fonction de la demande.
En parallèle, grâce à sa durée de vie sensiblement supérieure à celle des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, qui seront remplacées théoriquement tous les 25 ans, le prix du nucléaire peut rester compétitif en tenant compte de l’ensemble des coûts de la centrale…
Le comparatif des LCOE : comment le nucléaire parvient à être compétitif par rapport aux renouvelables
C’est le principe du LCOE, ou « coût actualisé de l’énergie ». Cette formule cumule l’ensemble des coûts pour produire une énergie et les divise par l’énergie effectivement produite. Le LCOE comptabilise ainsi :
- les dépenses d’investissements ;
- les coûts d’exploitation ;
- les coûts de maintenance ;
- le coût des combustibles nécessaires ;
- la durée de vie de l’équipement ;
- la somme des kWh produits.
Cela permet d’établir un comparatif hypothétique entre les énergies, selon un prix en euros par mégawattheure. Il sera toutefois susceptible d’évoluer en fonction du facteur de charge réel, de coûts supplémentaires non prévus, etc. Cela permet donc de guider la prise de décision entre les énergies, dans une stratégie globale de production d’électricité.
Pour le nucléaire, le dernier rapport de la CRE établissait pour le nucléaire existant – dont l’EPR de Flamanville-3 – un coût moyen de 60,3 €/MWh pour 2026-2028, puis de 63,4 €/MWh pour 2029-2031. Cependant, les dernières évaluations du LCOE pour les nouvelles grandes installations nucléaires sont largement supérieures, généralement au-dessus des 100 €/MWh.
Le nucléaire : une énergie qui ne dépend pas de facteurs extérieurs
Néanmoins, même si l’indicateur du LCOE semble montrer un avantage pour les filières les plus matures des énergies renouvelables, il reste à nuancer sur plusieurs aspects. Il dépend d’hypothèses de production, de facteur de charge de chaque installation, et surtout il ne prend pas en compte le coût induit sur le réseau – comme les besoins en flexibilité. Or, une « partie de la compétitivité de l’énergie nucléaire est liée à sa pilotabilité, c’est-à-dire à sa capacité à produire indépendamment des conditions extérieures (vent, soleil) », ajoute Maxence Cordiez.
Pour Xavier Ursat, l’essentiel pour les EPR2 est donc d’être compétitifs par rapport à d’autres moyens pilotables comme les cycles combinés gaz – en tenant compte de l’impact du coût du carbone pour ces derniers. Le nucléaire se présente comme une énergie rassurante, fiable. Son prix est également relativement stable pour les installations déjà existantes, avec un faible impact du combustible.
Aussi, ce LCOE ne présage pas du prix final pour les consommateurs. Celui-ci dépendra d’autres systèmes comme la vente par anticipation sur un marché à terme ou le principe du merit order, mais surtout de la fiscalité et des choix politiques. Le coût de fourniture ne représente aujourd’hui qu’un tiers de la facture finale.
Le défi du coût de construction
Construire de nouveaux réacteurs en série pour réduire les frais
Pour les EPR2 comme pour les SMR, la construction d’un seul réacteur représente un montant trop élevé. Il sera difficilement finançable par la seule utilisation de ce réacteur. Même en étant utile de manière – quasi – constante et en devenant un appui pour la stabilité du réseau, l’amortissement serait trop long.
Cependant, les énergéticiens comptent réduire les coûts, à terme, et rendre le nucléaire viable financièrement grâce à une notion : l’effet de série. Par la construction de plusieurs réacteurs sur des modèles identiques mais en léger décalage, il devient possible de réduire les frais de construction – chaque étape étant déjà connue, testée et industrialisée – pour baisser les coûts de production.
Pour les EPR2 en France, EDF envisage ainsi une stratégie de construction sur un même site de deux réacteurs avec une année d’écart. En parallèle, le développement de la filière à l’international et l’exportation du savoir-faire français en la matière pourrait augmenter la rentabilité de ces projets. La reprise en main par EDF de Framatome et Arabelle, constructeurs de composants essentiels pour les réacteurs, va également dans ce sens de maîtrise des coûts de construction.
L’appel aux investissements pour les nouvelles centrales
Pour parvenir à développer ces nouveaux réacteurs, il faut cependant des plans de financement. Pour les EPR2, c’est la charge d’EDF, qui doit le présenter avant la fin de l’année à son actionnaire : l’État français. En parallèle, il pourrait y avoir plusieurs options sollicitées pour trouver les fonds nécessaires à moindre coût. L’utilisation de l’épargne déposée sur le livret A est un levier envisagé.
Le ministre de l’Économie Roland Lescure a également évoqué dernièrement la possibilité d’avoir recours à des investissements venus de l’extérieur et du secteur privé en particulier, comme les fonds de pension, en ouverture du sommet mondial sur le nucléaire à Paris.
Cependant, pour ces acteurs, l’investissement dans le nucléaire de grande taille se révèle difficile puisqu’il s’étend sur une très longue période, supérieure à 40 ans en tenant compte de la durée de vie minimale de la centrale.
Les formules de type PPA (Power purchase agreement), même pour le nucléaire, s’intéressent donc plutôt aux projets de repowering – comme le font actuellement les Gafam aux États-Unis, avec d’anciennes centrales remises en service – ou aux projets de SMR – de taille plus modestes.
Le nucléaire : l’énergie d’une économie stable, prévisible… et bientôt flexible ?
Enfin, si les investissements sont coûteux pour construire de nouvelles centrales nucléaires et représentent un frein aujourd’hui, leur prix final pourrait être absorbé par la redistribution issue de mécanismes énergétiques comme la taxe carbone, par une fiscalité avantageuse et des emprunts soutenus par l’État.
Par ailleurs, la question de la dépendance aux importations des fossiles ajoute une part d’incertitudes économiques problématiques pour les industries et les activités économiques des pays européens. « Ce qui coûte cher, ce ne sont pas les centrales à gaz, résume Maxence Cordiez. C’est l’achat du gaz. » Or, à ce niveau-là, le nucléaire peut défendre un modèle économique à long terme plus intéressant. Le prix du nucléaire dépend peu de son combustible, ce qui le rend moins volatil – pour une construction terminée, hors maintenances éventuelles. « C’est très différent du gaz, où un doublement du prix du gaz entraîne une augmentation de 70 % du coût du production de l’électricité, pointe l’expert. Pour le consommateur, l’effet est immédiat, d’autant plus que le gaz est la plupart du temps marginal sur le réseau européen. Autrement dit, c’est lui qui fixe le plus souvent le prix de marché de l’électricité en général et non pas les centrales nucléaires. »
Enfin, les innovations dans le nucléaire comme des réacteurs de plus petite taille ou son couplage à un système de stockage thermique pourraient lui offrir d’autres débouchés économiques, avec des investissements moins importants.
La question du coût final de l’électricité : qui paiera pour ces nouveaux réacteurs ?
Malgré tout, le nucléaire est aujourd’hui une énergie chère. Elle n’est pas accessible à l’ensemble des pays. Elle s’adresse avant tout à des pays industrialisés, avec des besoins énergétiques précis – pour les industries, les data centers, etc. Le choix de relancer la filière dans un souci de décarbonation, de réindustrialisation et de maintien de la fiabilité du réseau électrique pourrait alors ne pas reposer seulement sur les consommateurs, sur un coût de l’électron qui correspond au coût de production, comme le précise Maxence Cordiez. « Les coûts des différentes énergies que nous allons devoir développer n’ont pas nécessairement vocation à être ventilés uniquement sur le prix payé par le consommateur au kilowattheure. »
En effet, le coût de l’électricité repose en partie sur des taxes, dont l’accise, qui contribuent au budget de l’État. Mais d’autres éléments pourraient, à l’inverse, contribuer à financer le système électrique. C’est le cas de la taxe carbone, également prélevée pour être redistribuée dans le budget de l’État mais qui pourrait subventionner la production d’électricité décarbonée.
D’autres taxes pourraient voir le jour et permettre de continuer le développement du parc nucléaire sans nuire au défi de l’électrification. Car l’objectif, avant 2050, c’est la décarbonation des usages pour les particuliers et pour les entreprises, du camping à l’industrie lourde, pour atteindre la neutralité carbone.
Conclusion : le nouveau nucléaire doit être un accélérateur de notre sortie des fossiles
« Que ce soit pour le climat, pour des difficultés d’accès – avec des gisements moins accessibles – ou du fait de problèmes géopolitiques [comme la dépendance au gaz russe avant 2022, ndlr], nous allons devoir faire sans les fossiles. » C’est l’urgence désormais, alors que l’objectif d’un réchauffement climatique limité à 1,5 °C s’éloigne. « Si on commence à mettre certaines solutions de côté comme l’éolien parce qu’on trouve ça moche, le nucléaire parce que ça fait peur, le biogaz parce que ça sent mauvais voire la sobriété parce qu’on ne veut pas revenir au Moyen-Âge, à la fin on garde les fossiles. Mais le jour où ça va vraiment taper… cela va faire mal. »
Le problème épineux des normes de sécurité
Mais cela requiert de favoriser l’ensemble des sources d’énergie bas carbone, en trouvant le bon équilibre dans leur développement. « Ce qui m’inquiète pour le nucléaire, c’est la philosophie du renforcement perpétuel de la sûreté. Un réacteur à risque nul, c’est un réacteur qui ne fonctionne pas. » Cette problématique pèse tout particulièrement sur le coût du nucléaire actuel et futur, de la construction à la maintenance. Le grand carénage pour prolonger la durée de vie des réacteurs a eu un coût élevé en partie à cause de cette difficulté.
Pour Maxence Cordiez, c’est l’un des points dont le nucléaire pourrait le plus pâtir… dans un sens comme dans l’autre. « Soit on accepte de se dire qu’on est arrivé à un niveau de sûreté déjà très haut et qu’on le stabilise, soit on continue à l’augmenter et nous risquons de bloquer l’industrie nucléaire… Cela peut aboutir à une situation de rupture comme aux États-Unis où Donald Trump a considérablement affaibli l’autorité de sûreté et lui a retiré son indépendance… au détriment de la sûreté nucléaire. C’est un vrai risque. »
Et répondre à l’enjeu d’une électricité décarbonée et abondante
Pour réussir sa transition énergétique, la France ne semble pas pouvoir faire sans le nucléaire. Les nouveaux réacteurs annoncés par Emmanuel Macron lors de son discours de Belfort doivent soutenir une électrification plus rapide des usages. « L’ampleur du défi est tel que nous aurons besoin de tous les outils, dont le nucléaire car il est pilotable. On le voit dans l’ensemble des scénarios de RTE. Les renouvelables vont connaître une croissance extrêmement significative, comme le solaire photovoltaïque. Il suffit de regarder ce qui se passe en Chine pour s’en convaincre. Mais il ne répond pas à la totalité de la demande. »
Il reste à régler la question du prix de ces énergies, dont le nucléaire. C’est tout l’enjeu désormais d’une stratégie d’incitation aux usages électriques, par exemple avec une fiscalité plus avantageuse, mais aussi d’une 3e PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) pour donner des perspectives d’investissement à l’ensemble des filières de production d’électricité… Mais cette dernière est toujours attendue, bien que le gouvernement de Sébastien Lecornu et son ministre de l’Économie et de l’Énergie Roland Lescure assurent qu’elle fait partie des priorités.

Article rédigé par Côme Tessier
Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.
« Il y a un modèle à trouver, un marché, mais qui n’est plus nécessairement uniquement celui qui était envisagé dans les années 80-90, à savoir la seule production d’électricité en base. Il faut que le nucléaire devienne compatible économiquement avec le système dans lequel il évolue », analyse Maxence Cordiez. En effet, la question du modèle économique du nucléaire est devenue centrale face aux bouleversements que connait le secteur de l’électricité.
En 2025, les notions de peakload et de baseload, auparavant fondamentales pour expliquer les variations des prix de l’énergie, n’ont plus autant de sens. Avec l’installation des renouvelables, l’émergence des batteries de stockage et le développement de l’autoconsommation, la consommation n’est plus aussi stable. Les prix sont désormais bas en milieu de journée. Les variations sont marquées sur des temps courts, en début de matinée et de soirée. La flexibilité gagne également du terrain et le système du merit order donne moins de marge au nucléaire. Certains clament déjà la mort de l’électricité baseload.
Pourtant, dans le même temps, l’intérêt pour le nucléaire est vif. Les deux premières parties de notre dossier l’ont démontré. Des pays misent à nouveau sur cette énergie, qui intéresse tant pour les services rendus, avec une production stable, prédictible, rassurante, que pour ses innovations et les nouveaux modèles de production proposés. Mais le nucléaire peut-il trouver une viabilité économique dans le nouveau fonctionnement des marchés de l’électricité ? Son rôle sera-t-il le même à l’avenir, alors que ses coûts de construction demeurent souvent rédhibitoire pour les investisseurs privés ?
Pour que le nucléaire se taille une part du marché de l’énergie, cela va devoir passer à la fois par une certaine maîtrise financière de son LCOE, pour être compétitive tout en devenant un soutien à des énergies émergentes comme le solaire et l’éolien, mais aussi par d’éventuels choix fiscaux pour inciter à la consommation d’électricité et soutenir l’usage de l’ensemble des énergies décarbonées. Ce choix stratégique nécessite une réflexion plus large sur les arbitrages économiques dans la consommation d’énergie.
Cet article fait partie d’un dossier plus complet sur l’avenir du nucléaire en France et dans le monde. La première partie s’intéressait aux différentes stratégies nationales. La deuxième partie s’intéressait aux innovations du secteur pour répondre aux besoins du système énergétique : petits réacteurs, nouveaux combustibles, modèles flexibles…
Quels sont les avantages économiques du nouveau nucléaire ?
Le coût du nucléaire dépend en majeure partie de sa construction, un investissement qui se compte en milliards d’euros. Xavier Ursat, dans un entretien avec Capgemini, précise : « C’est notre véritable enjeu [alors qu’EDF] est en train de finaliser le coût et le planning qui va servir à fonder la décision d’investissement » pour les EPR2.
Selon les calculs d’Ey-Parthenon, ce montant sera particulièrement élevé dans les cinq ans à venir, avant de décroître sur les deux décennies suivantes. Ainsi, l’investissement annuel mondial plafonnerait jusqu’à 159 milliards de dollars par an, pour ensuite atteindre environ 76 milliards en 2050, en étant fléché presque intégralement vers la construction.
Néanmoins, la filière peut faire valoir des coûts moindres pour l’ensemble du système électrique. Le nucléaire réduit les besoins de flexibilité et de gestion du réseau, puisqu’il fournit une énergie de base centralisée. Son électricité est plus simple à coordonner en fonction de la demande.
En parallèle, grâce à sa durée de vie sensiblement supérieure à celle des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, qui seront remplacées théoriquement tous les 25 ans, le prix du nucléaire peut rester compétitif en tenant compte de l’ensemble des coûts de la centrale…
Le comparatif des LCOE : comment le nucléaire parvient à être compétitif par rapport aux renouvelables
C’est le principe du LCOE, ou « coût actualisé de l’énergie ». Cette formule cumule l’ensemble des coûts pour produire une énergie et les divise par l’énergie effectivement produite. Le LCOE comptabilise ainsi :
- les dépenses d’investissements ;
- les coûts d’exploitation ;
- les coûts de maintenance ;
- le coût des combustibles nécessaires ;
- la durée de vie de l’équipement ;
- la somme des kWh produits.
Cela permet d’établir un comparatif hypothétique entre les énergies, selon un prix en euros par mégawattheure. Il sera toutefois susceptible d’évoluer en fonction du facteur de charge réel, de coûts supplémentaires non prévus, etc. Cela permet donc de guider la prise de décision entre les énergies, dans une stratégie globale de production d’électricité.
Pour le nucléaire, le dernier rapport de la CRE établissait pour le nucléaire existant – dont l’EPR de Flamanville-3 – un coût moyen de 60,3 €/MWh pour 2026-2028, puis de 63,4 €/MWh pour 2029-2031. Cependant, les dernières évaluations du LCOE pour les nouvelles grandes installations nucléaires sont largement supérieures, généralement au-dessus des 100 €/MWh.
Le nucléaire : une énergie qui ne dépend pas de facteurs extérieurs
Néanmoins, même si l’indicateur du LCOE semble montrer un avantage pour les filières les plus matures des énergies renouvelables, il reste à nuancer sur plusieurs aspects. Il dépend d’hypothèses de production, de facteur de charge de chaque installation, et surtout il ne prend pas en compte le coût induit sur le réseau – comme les besoins en flexibilité. Or, une « partie de la compétitivité de l’énergie nucléaire est liée à sa pilotabilité, c’est-à-dire à sa capacité à produire indépendamment des conditions extérieures (vent, soleil) », ajoute Maxence Cordiez.
Pour Xavier Ursat, l’essentiel pour les EPR2 est donc d’être compétitifs par rapport à d’autres moyens pilotables comme les cycles combinés gaz – en tenant compte de l’impact du coût du carbone pour ces derniers. Le nucléaire se présente comme une énergie rassurante, fiable. Son prix est également relativement stable pour les installations déjà existantes, avec un faible impact du combustible.
Aussi, ce LCOE ne présage pas du prix final pour les consommateurs. Celui-ci dépendra d’autres systèmes comme la vente par anticipation sur un marché à terme ou le principe du merit order, mais surtout de la fiscalité et des choix politiques. Le coût de fourniture ne représente aujourd’hui qu’un tiers de la facture finale.
Le défi du coût de construction
Construire de nouveaux réacteurs en série pour réduire les frais
Pour les EPR2 comme pour les SMR, la construction d’un seul réacteur représente un montant trop élevé. Il sera difficilement finançable par la seule utilisation de ce réacteur. Même en étant utile de manière – quasi – constante et en devenant un appui pour la stabilité du réseau, l’amortissement serait trop long.
Cependant, les énergéticiens comptent réduire les coûts, à terme, et rendre le nucléaire viable financièrement grâce à une notion : l’effet de série. Par la construction de plusieurs réacteurs sur des modèles identiques mais en léger décalage, il devient possible de réduire les frais de construction – chaque étape étant déjà connue, testée et industrialisée – pour baisser les coûts de production.
Pour les EPR2 en France, EDF envisage ainsi une stratégie de construction sur un même site de deux réacteurs avec une année d’écart. En parallèle, le développement de la filière à l’international et l’exportation du savoir-faire français en la matière pourrait augmenter la rentabilité de ces projets. La reprise en main par EDF de Framatome et Arabelle, constructeurs de composants essentiels pour les réacteurs, va également dans ce sens de maîtrise des coûts de construction.
L’appel aux investissements pour les nouvelles centrales
Pour parvenir à développer ces nouveaux réacteurs, il faut cependant des plans de financement. Pour les EPR2, c’est la charge d’EDF, qui doit le présenter avant la fin de l’année à son actionnaire : l’État français. En parallèle, il pourrait y avoir plusieurs options sollicitées pour trouver les fonds nécessaires à moindre coût. L’utilisation de l’épargne déposée sur le livret A est un levier envisagé.
Le ministre de l’Économie Roland Lescure a également évoqué dernièrement la possibilité d’avoir recours à des investissements venus de l’extérieur et du secteur privé en particulier, comme les fonds de pension, en ouverture du sommet mondial sur le nucléaire à Paris.
Cependant, pour ces acteurs, l’investissement dans le nucléaire de grande taille se révèle difficile puisqu’il s’étend sur une très longue période, supérieure à 40 ans en tenant compte de la durée de vie minimale de la centrale.
Les formules de type PPA (Power purchase agreement), même pour le nucléaire, s’intéressent donc plutôt aux projets de repowering – comme le font actuellement les Gafam aux États-Unis, avec d’anciennes centrales remises en service – ou aux projets de SMR – de taille plus modestes.
Le nucléaire : l’énergie d’une économie stable, prévisible… et bientôt flexible ?
Enfin, si les investissements sont coûteux pour construire de nouvelles centrales nucléaires et représentent un frein aujourd’hui, leur prix final pourrait être absorbé par la redistribution issue de mécanismes énergétiques comme la taxe carbone, par une fiscalité avantageuse et des emprunts soutenus par l’État.
Par ailleurs, la question de la dépendance aux importations des fossiles ajoute une part d’incertitudes économiques problématiques pour les industries et les activités économiques des pays européens. « Ce qui coûte cher, ce ne sont pas les centrales à gaz, résume Maxence Cordiez. C’est l’achat du gaz. » Or, à ce niveau-là, le nucléaire peut défendre un modèle économique à long terme plus intéressant. Le prix du nucléaire dépend peu de son combustible, ce qui le rend moins volatil – pour une construction terminée, hors maintenances éventuelles. « C’est très différent du gaz, où un doublement du prix du gaz entraîne une augmentation de 70 % du coût du production de l’électricité, pointe l’expert. Pour le consommateur, l’effet est immédiat, d’autant plus que le gaz est la plupart du temps marginal sur le réseau européen. Autrement dit, c’est lui qui fixe le plus souvent le prix de marché de l’électricité en général et non pas les centrales nucléaires. »
Enfin, les innovations dans le nucléaire comme des réacteurs de plus petite taille ou son couplage à un système de stockage thermique pourraient lui offrir d’autres débouchés économiques, avec des investissements moins importants.
La question du coût final de l’électricité : qui paiera pour ces nouveaux réacteurs ?
Malgré tout, le nucléaire est aujourd’hui une énergie chère. Elle n’est pas accessible à l’ensemble des pays. Elle s’adresse avant tout à des pays industrialisés, avec des besoins énergétiques précis – pour les industries, les data centers, etc. Le choix de relancer la filière dans un souci de décarbonation, de réindustrialisation et de maintien de la fiabilité du réseau électrique pourrait alors ne pas reposer seulement sur les consommateurs, sur un coût de l’électron qui correspond au coût de production, comme le précise Maxence Cordiez. « Les coûts des différentes énergies que nous allons devoir développer n’ont pas nécessairement vocation à être ventilés uniquement sur le prix payé par le consommateur au kilowattheure. »
En effet, le coût de l’électricité repose en partie sur des taxes, dont l’accise, qui contribuent au budget de l’État. Mais d’autres éléments pourraient, à l’inverse, contribuer à financer le système électrique. C’est le cas de la taxe carbone, également prélevée pour être redistribuée dans le budget de l’État mais qui pourrait subventionner la production d’électricité décarbonée.
D’autres taxes pourraient voir le jour et permettre de continuer le développement du parc nucléaire sans nuire au défi de l’électrification. Car l’objectif, avant 2050, c’est la décarbonation des usages pour les particuliers et pour les entreprises, du camping à l’industrie lourde, pour atteindre la neutralité carbone.
Conclusion : le nouveau nucléaire doit être un accélérateur de notre sortie des fossiles
« Que ce soit pour le climat, pour des difficultés d’accès – avec des gisements moins accessibles – ou du fait de problèmes géopolitiques [comme la dépendance au gaz russe avant 2022, ndlr], nous allons devoir faire sans les fossiles. » C’est l’urgence désormais, alors que l’objectif d’un réchauffement climatique limité à 1,5 °C s’éloigne. « Si on commence à mettre certaines solutions de côté comme l’éolien parce qu’on trouve ça moche, le nucléaire parce que ça fait peur, le biogaz parce que ça sent mauvais voire la sobriété parce qu’on ne veut pas revenir au Moyen-Âge, à la fin on garde les fossiles. Mais le jour où ça va vraiment taper… cela va faire mal. »
Le problème épineux des normes de sécurité
Mais cela requiert de favoriser l’ensemble des sources d’énergie bas carbone, en trouvant le bon équilibre dans leur développement. « Ce qui m’inquiète pour le nucléaire, c’est la philosophie du renforcement perpétuel de la sûreté. Un réacteur à risque nul, c’est un réacteur qui ne fonctionne pas. » Cette problématique pèse tout particulièrement sur le coût du nucléaire actuel et futur, de la construction à la maintenance. Le grand carénage pour prolonger la durée de vie des réacteurs a eu un coût élevé en partie à cause de cette difficulté.
Pour Maxence Cordiez, c’est l’un des points dont le nucléaire pourrait le plus pâtir… dans un sens comme dans l’autre. « Soit on accepte de se dire qu’on est arrivé à un niveau de sûreté déjà très haut et qu’on le stabilise, soit on continue à l’augmenter et nous risquons de bloquer l’industrie nucléaire… Cela peut aboutir à une situation de rupture comme aux États-Unis où Donald Trump a considérablement affaibli l’autorité de sûreté et lui a retiré son indépendance… au détriment de la sûreté nucléaire. C’est un vrai risque. »
Et répondre à l’enjeu d’une électricité décarbonée et abondante
Pour réussir sa transition énergétique, la France ne semble pas pouvoir faire sans le nucléaire. Les nouveaux réacteurs annoncés par Emmanuel Macron lors de son discours de Belfort doivent soutenir une électrification plus rapide des usages. « L’ampleur du défi est tel que nous aurons besoin de tous les outils, dont le nucléaire car il est pilotable. On le voit dans l’ensemble des scénarios de RTE. Les renouvelables vont connaître une croissance extrêmement significative, comme le solaire photovoltaïque. Il suffit de regarder ce qui se passe en Chine pour s’en convaincre. Mais il ne répond pas à la totalité de la demande. »
Il reste à régler la question du prix de ces énergies, dont le nucléaire. C’est tout l’enjeu désormais d’une stratégie d’incitation aux usages électriques, par exemple avec une fiscalité plus avantageuse, mais aussi d’une 3e PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) pour donner des perspectives d’investissement à l’ensemble des filières de production d’électricité… Mais cette dernière est toujours attendue, bien que le gouvernement de Sébastien Lecornu et son ministre de l’Économie et de l’Énergie Roland Lescure assurent qu’elle fait partie des priorités.

Article rédigé par Côme Tessier
Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.