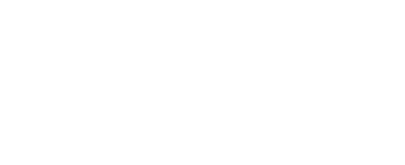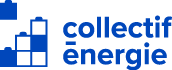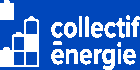Vendredi, lors d’une audition parlementaire, Monique Barbut a clarifié sa position sur l’avenir énergétique français. La ministre de la Transition écologique a répondu directement aux accusations de l’extrême droite qui la présentent comme opposée à l’atome, un reproche lié à son passé de présidente de WWF France.
Peut-on vraiment se passer d’une énergie complémentaire ?
Face à la commission du Développement durable de l’Assemblée nationale, Monique Barbut a défendu une vision pragmatique : le système énergétique français a besoin de s’appuyer sur deux piliers complémentaires, les énergies renouvelables et le nucléaire. Elle a tenu à préciser qu’elle n’était absolument pas hostile à l’atome, contrairement à ce que certains affirment.
Cette déclaration intervient après une question du député Sébastien Humbert (RN), qui reprenait des critiques visant l’ancienne dirigeante de WWF France. Pour la ministre, il faut bien avouer que compter sur une seule source d’énergie relève de l’illusion.
Selon elle, la souveraineté énergétique passe nécessairement par la diversification des sources d’approvisionnement. Se limiter au nucléaire serait une erreur stratégique, tout comme se priver de cette technologie au profit des seules énergies renouvelables.
Quelle diversité énergétique pour la France ?
Monique Barbut a détaillé sa vision d’un mix énergétique complet, sans hiérarchie idéologique entre les différentes sources. Elle a énuméré le nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydraulique et la géothermie comme autant de filières à développer de manière coordonnée.
Cette approche vise à garantir l’indépendance énergétique du pays en multipliant les options disponibles. Pour comprendre cette logique, on peut la résumer ainsi : chaque source d’énergie possède ses forces et ses limites, et c’est leur combinaison qui assure la résilience du système.
Comment concilier urgence climatique et réalités sociales ?
La ministre a rappelé l’urgence de la situation environnementale sans perdre de vue les contraintes économiques et sociales. Elle a évoqué les signes quotidiens du dérèglement climatique : vagues de chaleur précoces, catastrophes climatiques, fonte accélérée des glaciers. Mais elle a insisté sur un point central : la cause écologique ne doit pas être mise en opposition à la justice sociale.
Cette déclaration répond en partie aux inquiétudes exprimées par des députés de gauche, qui lui ont reproché un budget 2026 insuffisant sur les questions écologiques.
Le budget 2026 est-il à la hauteur des enjeux ?
Face aux critiques sur les moyens financiers alloués à l’écologie, Monique Barbut a reconnu les limites tout en défendant le réalisme budgétaire. Elle a qualifié le budget présenté de rêve en noir et blanc, soulignant qu’il n’avait pas été élaboré par son équipe. Elle estime néanmoins qu’il reste acceptable compte tenu de la situation budgétaire actuelle. Elle a renvoyé la balle aux parlementaires, leur rappelant que le Premier ministre leur avait confié la mission de transformer ce rêve en couleurs.
Plus globalement, elle a défendu une vision où l’État ne porte pas seul le financement de la transformation écologique. Pour elle, le rôle de l’État consiste à mettre en place les lois et règlements qui orientent l’ensemble de l’économie vers les bonnes trajectoires, plutôt que d’assumer seul le financement de la transition.
En synthèse, Monique Barbut propose une approche équilibrée qui cherche à dépasser les clivages idéologiques sur l’énergie. Son message aux parlementaires : la transition écologique passe par la diversification énergétique et par un cadre réglementaire qui mobilise toute l’économie, pas uniquement l’argent public.

Article rédigé par Guillaume Sagliet
Growth Marketing Manager pour Collectif Énergie, je suis devenu expert pour retrouver les pages perdues dans l’Internet et leur redonner vie grâce à mes connaissances approfondies dans Lost et The Walking Dead. Avec moi, tous les contenus affrontent Google sans crainte.
Vendredi, lors d’une audition parlementaire, Monique Barbut a clarifié sa position sur l’avenir énergétique français. La ministre de la Transition écologique a répondu directement aux accusations de l’extrême droite qui la présentent comme opposée à l’atome, un reproche lié à son passé de présidente de WWF France.
Peut-on vraiment se passer d’une énergie complémentaire ?
Face à la commission du Développement durable de l’Assemblée nationale, Monique Barbut a défendu une vision pragmatique : le système énergétique français a besoin de s’appuyer sur deux piliers complémentaires, les énergies renouvelables et le nucléaire. Elle a tenu à préciser qu’elle n’était absolument pas hostile à l’atome, contrairement à ce que certains affirment.
Cette déclaration intervient après une question du député Sébastien Humbert (RN), qui reprenait des critiques visant l’ancienne dirigeante de WWF France. Pour la ministre, il faut bien avouer que compter sur une seule source d’énergie relève de l’illusion.
Selon elle, la souveraineté énergétique passe nécessairement par la diversification des sources d’approvisionnement. Se limiter au nucléaire serait une erreur stratégique, tout comme se priver de cette technologie au profit des seules énergies renouvelables.
Quelle diversité énergétique pour la France ?
Monique Barbut a détaillé sa vision d’un mix énergétique complet, sans hiérarchie idéologique entre les différentes sources. Elle a énuméré le nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydraulique et la géothermie comme autant de filières à développer de manière coordonnée.
Cette approche vise à garantir l’indépendance énergétique du pays en multipliant les options disponibles. Pour comprendre cette logique, on peut la résumer ainsi : chaque source d’énergie possède ses forces et ses limites, et c’est leur combinaison qui assure la résilience du système.
Comment concilier urgence climatique et réalités sociales ?
La ministre a rappelé l’urgence de la situation environnementale sans perdre de vue les contraintes économiques et sociales. Elle a évoqué les signes quotidiens du dérèglement climatique : vagues de chaleur précoces, catastrophes climatiques, fonte accélérée des glaciers. Mais elle a insisté sur un point central : la cause écologique ne doit pas être mise en opposition à la justice sociale.
Cette déclaration répond en partie aux inquiétudes exprimées par des députés de gauche, qui lui ont reproché un budget 2026 insuffisant sur les questions écologiques.
Le budget 2026 est-il à la hauteur des enjeux ?
Face aux critiques sur les moyens financiers alloués à l’écologie, Monique Barbut a reconnu les limites tout en défendant le réalisme budgétaire. Elle a qualifié le budget présenté de rêve en noir et blanc, soulignant qu’il n’avait pas été élaboré par son équipe. Elle estime néanmoins qu’il reste acceptable compte tenu de la situation budgétaire actuelle. Elle a renvoyé la balle aux parlementaires, leur rappelant que le Premier ministre leur avait confié la mission de transformer ce rêve en couleurs.
Plus globalement, elle a défendu une vision où l’État ne porte pas seul le financement de la transformation écologique. Pour elle, le rôle de l’État consiste à mettre en place les lois et règlements qui orientent l’ensemble de l’économie vers les bonnes trajectoires, plutôt que d’assumer seul le financement de la transition.
En synthèse, Monique Barbut propose une approche équilibrée qui cherche à dépasser les clivages idéologiques sur l’énergie. Son message aux parlementaires : la transition écologique passe par la diversification énergétique et par un cadre réglementaire qui mobilise toute l’économie, pas uniquement l’argent public.

Article rédigé par Guillaume Sagliet
Growth Marketing Manager pour Collectif Énergie, je suis devenu expert pour retrouver les pages perdues dans l’Internet et leur redonner vie grâce à mes connaissances approfondies dans Lost et The Walking Dead. Avec moi, tous les contenus affrontent Google sans crainte.