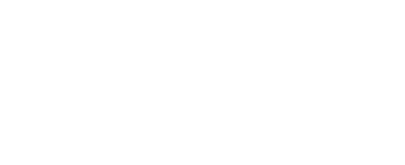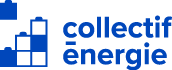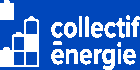Les futures applications du nucléaire en France et dans le monde ne reposent plus seulement sur des réacteurs de forte puissance. À pleine puissance, l’EPR de Flamanville-3 pourra atteindre 1600 MW. Les futurs EPR2 devraient suivre ce modèle. Mais ces réacteurs de forte puissance sont-ils la seule manière de concevoir le nucléaire du futur ? Dans des pays qui souhaitent soutenir le développement d’une nouvelle filière du nucléaire ou y revenir après un premier abandon, s’agit-il nécessairement de grandes capacités de production ?
Des innovations permettent d’envisager des usages différents du nucléaire, parfois plus décentralisés ou concentrés sur une utilisation du nucléaire spécifique, comme la production de chaleur. Ainsi, de nouveaux réacteurs et des prototypes différents se développent pour répondre aux attentes des industriels, voire en accolant le modèle du nucléaire à celui des énergies renouvelables. Le nucléaire du demain est-il vraiment celui qui fonctionnera en base uniquement ? Quelles alternatives sont disponibles ?
Voici un petit tour d’horizon des innovations qui voient le jour dans le secteur de l’atome et qui pourraient appuyer une autre vision de l’énergie du futur.
Cet article fait partie d’un dossier plus complet sur l’avenir du nucléaire en France et dans le monde. La première partie s’intéressait aux différentes stratégies nationales.
L’axe stratégique des small modular reactors (SMR)
C’est l’un des enjeux relevés par le dernier conseil de politique nucléaire : développer et stimuler la construction de plus petits réacteurs. Ce soutien aux entreprises développant des SMR a été intégré au plan d’investissements France 2030 pour permettre de décarboner plus rapidement des usages énergétiques complexes ou importants.
La miniaturisation des réacteurs nucléaires
En allant à rebours d’une logique de grande capacité de production, les SMR offrent davantage de flexibilité et des solutions à des problèmes techniques pour l’électricité, notamment lorsqu’il s’agit de fournir du courant dans des zones isolées.
Finalement, le SMR s’adapte à un réseau électrique plus décentralisé, comme le font les ENR. Par ailleurs, ces petits réacteurs d’une puissance variable – entre 10 et 300 MW – peuvent fournir une énergie adaptée à d’autres usages comme le dessalement de l’eau, la production d’hydrogène rose (c’est-à-dire d’origine nucléaire) ou encore les besoins en chaleur de l’industrie métallurgique.
Au service de leur viabilité et flexibilité
Enfin, les SMR présentent l’avantage d’être un investissement davantage supportable pour des acteurs privés. En dehors de projets menés par de grands groupes énergétiques, comme EDF avec Nuward, des start-ups comme Newcleo ou Jimmy tentent de développer ces SMR grâce au soutien de l’Etat. Mais leur financement reste fragile, avec par exemple le placement en redressement judiciaire de la start-up Naarea à l’été 2025.
D’autant plus qu’avec une puissance moindre, l’amortissement de ce type de réacteur sera également plus long. L’enjeu pour les énergéticiens qui développent ces SMR est donc de pouvoir les multiplier pour bénéficier de l’effet de série, avec des coûts de construction qui diminueront dans le temps.
Les réacteurs à neutrons rapides (RNR) de IVe génération
Des réacteurs pour une nouvelle gestion des déchets nucléaires
En parallèle, les recherches dans le secteur du nucléaire s’intéresse à la « fermeture du cycle » avec les réacteurs de quatrième génération. Pourquoi ne pas recycler le combustible d’uranium déjà utilisé ? En effet, à la sortie d’un réacteur, ce combustible contient 1 % de plutonium et 4 % de déchets ultimes. L’idée est donc de récupérer les 95 % d’uranium, ainsi que ce plutonium, pour les réemployer dans des réacteurs à neutrons rapides (RNR).
Cet objectif a lui aussi été confirmé en 2025 lors du 4e Conseil de politique nucléaire mené depuis le discours de Belfort. Un programme de travail est en cours pour que ce stade soit atteint « dans la deuxième moitié du siècle », ce conseil soulignant que « des développements technologiques importants sont nécessaires pour fabriquer les combustibles à partir de plutonium et d’uranium appauvri, la maitrise des réacteurs à neutrons rapides ainsi que le retraitement des combustibles ».
Et avancer vers l’autonomie énergétique
Grâce à cela, la France aurait la capacité de stopper les importations d’uranium sur des milliers d’années. Cela assurerait au nucléaire une force certaine pour garantir l’indépendance énergétique du pays. Ces réacteurs présentent également un intérêt pour décarboner les industries lourdes, puisqu’ils produisent une chaleur à très haute température (500 °C).
C’est sur ce principe que travaille Hexana, en proposant un stockage thermique qui garantit davantage de flexibilité. « Cela permet de produire de la chaleur pour l’industrie ainsi que de l’électricité flexible sans dégrader le modèle économique du nucléaire, puisque le réacteur produit toujours en base », précise l’expert Maxence Cordiez. Une politique française d’investissements sur cette filière, comme une partie du programme France 2030 destinée à son développement – avec initialement 1 milliard d’euros fléchés vers le nucléaire –, peut ainsi répondre à ces enjeux de réindustrialisation et de souveraineté.
Des alternatives technologiques émergentes : des sels fondus à la fusion nucléaire
Des réacteurs verts et moins gourmands ?
D’autres innovations pourraient faire du nucléaire une source fiable pour contribuer à la décarbonation de nos sociétés et de nos besoins industriels. Il s’agit par exemple des réacteurs à sels fondus. Ces derniers sont particulièrement envisagés pour exploiter le thorium, un élément chimique davantage présent que l’uranium dans la croûte terrestre, bien qu’ils puissent également fonctionner avec un cycle uranium-plutonium. Ces réacteurs sont également prisés car ils produisent moins de déchets radioactifs, comme l’explique l’AIEA dans son article sur le sujet.
La Chine a octroyé un permis d’exploitation à un premier réacteur de ce type en 2023. L’Inde pourrait être l’un des pays qui en bénéficierait le plus pour réduire son empreinte carbone sur le long terme, grâce également à d’importantes réserves de thorium dans son sous-sol. Cela permettrait au pays de s’affranchir également des contraintes de l’achat d’uranium à des pays tiers, alors qu’il a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire.
L’espoir d’une énergie infinie : la fusion nucléaire
En parallèle, des travaux sont menés sur la fusion nucléaire pour parvenir à reproduire une énergie comparable à celle produite par le soleil. La fusion nucléaire, si elle est maîtrisée, offrirait à nos sociétés une énergie quasi illimitée et bas carbone. Sa maîtrise est cependant difficile et requiert de longs travaux de recherche. Pour y parvenir, 33 pays (depuis le départ temporaire de la Suisse notamment) collaborent en ce sens au sein de l’AIEA. Cela se matérialise avec le projet Iter, basé dans le sud de la France, au lieu-dit Cadarache de Saint-Paul-lez-Durance.
Un début d’exploitation du tokamak d’Iter est actuellement envisagé à partir de 2034, mais sa commercialisation pour alimenter les systèmes énergétiques ne devrait pas intervenir avant… 2075. Bien que très prometteur, son usage apparaît donc aujourd’hui trop tardif pour permettre d’atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Conclusion : le nucléaire est encore un secteur d’innovation
Le nouveau nucléaire est un secteur plein de promesses. Il pourrait offrir davantage de flexibilité, des solutions de stockage, des ressources moins contraignantes avec moins de déchets et un cycle fermé du combustible.
Mais ces nouvelles exploitations envisagées pour le nucléaire nécessitent donc de lourds investissements. Il lui faudra aussi du temps, beaucoup de temps parfois pour réussir à se développer et à se faire une place dans un système énergétique déjà bien fourni.
Enfin, il aura besoin de débouchés pour sa production électrique, à un prix compétitif – pour sa rentabilité comme pour les consommateurs, ou par rapport aux autres sources de production. Tous ces éléments peuvent rendre l’idée d’un nouveau nucléaire comme socle de la production d’électricité assez fragile, en 2025.
Avec des atouts à défendre
Cependant, ces potentiels réacteurs ont chacun des atouts à défendre. L’EPR (et l’EPR2) est un très bon moyen de fabriquer de l’électricité stable et prédictible, dans un contexte de demande facilement identifiable, bien que ce modèle soit concurrencé et affaibli par des ENR qui apportent régulièrement de l’électricité à très bon marché, par l’émergence de l’autoconsommation qui réduit la demande sur le réseau électrique général, etc.
C’est en grande partie ce modèle qui a été choisi par les pays qui souhaitent relancer la filière du nucléaire dès maintenant, avec des réacteurs de grande puissance. Dans le même temps, ces pays pourraient s’appuyer sur des réacteurs plus modulaires, compacts, avec un usage précis. C’est le cas des SMR, qui ont un rôle à jouer dans un système qui aura besoin d’un maillage fin et précis pour aligner offre et demande.
Mais qui cherche son modèle économique ?
Mais il reste un nœud à démêler : comment imaginer et rendre rentables ces différentes possibilités du nucléaire ? Dans quel mix énergétique pour 2050 et au-delà peuvent-ils se développer, tout en maintenant cette garantie essentielle d’une électrification des usages intéressante, accessible et même rentable pour les industriels, les particuliers, les entreprises du tertiaire ?
Le modèle économique du futur nucléaire est dépendant du besoin d’un signal prix favorable à la consommation d’électricité (ou de chaleur décarbonée) pour être au service de la décarbonation. Il doit donc être à la fois bon marché… et rentable.
[Le dernier article de ce dossier abordera la question des coûts et du financement du nucléaire.]

Article rédigé par Côme Tessier
Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.
Les futures applications du nucléaire en France et dans le monde ne reposent plus seulement sur des réacteurs de forte puissance. À pleine puissance, l’EPR de Flamanville-3 pourra atteindre 1600 MW. Les futurs EPR2 devraient suivre ce modèle. Mais ces réacteurs de forte puissance sont-ils la seule manière de concevoir le nucléaire du futur ? Dans des pays qui souhaitent soutenir le développement d’une nouvelle filière du nucléaire ou y revenir après un premier abandon, s’agit-il nécessairement de grandes capacités de production ?
Des innovations permettent d’envisager des usages différents du nucléaire, parfois plus décentralisés ou concentrés sur une utilisation du nucléaire spécifique, comme la production de chaleur. Ainsi, de nouveaux réacteurs et des prototypes différents se développent pour répondre aux attentes des industriels, voire en accolant le modèle du nucléaire à celui des énergies renouvelables. Le nucléaire du demain est-il vraiment celui qui fonctionnera en base uniquement ? Quelles alternatives sont disponibles ?
Voici un petit tour d’horizon des innovations qui voient le jour dans le secteur de l’atome et qui pourraient appuyer une autre vision de l’énergie du futur.
Cet article fait partie d’un dossier plus complet sur l’avenir du nucléaire en France et dans le monde. La première partie s’intéressait aux différentes stratégies nationales.
L’axe stratégique des small modular reactors (SMR)
C’est l’un des enjeux relevés par le dernier conseil de politique nucléaire : développer et stimuler la construction de plus petits réacteurs. Ce soutien aux entreprises développant des SMR a été intégré au plan d’investissements France 2030 pour permettre de décarboner plus rapidement des usages énergétiques complexes ou importants.
La miniaturisation des réacteurs nucléaires
En allant à rebours d’une logique de grande capacité de production, les SMR offrent davantage de flexibilité et des solutions à des problèmes techniques pour l’électricité, notamment lorsqu’il s’agit de fournir du courant dans des zones isolées.
Finalement, le SMR s’adapte à un réseau électrique plus décentralisé, comme le font les ENR. Par ailleurs, ces petits réacteurs d’une puissance variable – entre 10 et 300 MW – peuvent fournir une énergie adaptée à d’autres usages comme le dessalement de l’eau, la production d’hydrogène rose (c’est-à-dire d’origine nucléaire) ou encore les besoins en chaleur de l’industrie métallurgique.
Au service de leur viabilité et flexibilité
Enfin, les SMR présentent l’avantage d’être un investissement davantage supportable pour des acteurs privés. En dehors de projets menés par de grands groupes énergétiques, comme EDF avec Nuward, des start-ups comme Newcleo ou Jimmy tentent de développer ces SMR grâce au soutien de l’Etat. Mais leur financement reste fragile, avec par exemple le placement en redressement judiciaire de la start-up Naarea à l’été 2025.
D’autant plus qu’avec une puissance moindre, l’amortissement de ce type de réacteur sera également plus long. L’enjeu pour les énergéticiens qui développent ces SMR est donc de pouvoir les multiplier pour bénéficier de l’effet de série, avec des coûts de construction qui diminueront dans le temps.
Les réacteurs à neutrons rapides (RNR) de IVe génération
Des réacteurs pour une nouvelle gestion des déchets nucléaires
En parallèle, les recherches dans le secteur du nucléaire s’intéresse à la « fermeture du cycle » avec les réacteurs de quatrième génération. Pourquoi ne pas recycler le combustible d’uranium déjà utilisé ? En effet, à la sortie d’un réacteur, ce combustible contient 1 % de plutonium et 4 % de déchets ultimes. L’idée est donc de récupérer les 95 % d’uranium, ainsi que ce plutonium, pour les réemployer dans des réacteurs à neutrons rapides (RNR).
Cet objectif a lui aussi été confirmé en 2025 lors du 4e Conseil de politique nucléaire mené depuis le discours de Belfort. Un programme de travail est en cours pour que ce stade soit atteint « dans la deuxième moitié du siècle », ce conseil soulignant que « des développements technologiques importants sont nécessaires pour fabriquer les combustibles à partir de plutonium et d’uranium appauvri, la maitrise des réacteurs à neutrons rapides ainsi que le retraitement des combustibles ».
Et avancer vers l’autonomie énergétique
Grâce à cela, la France aurait la capacité de stopper les importations d’uranium sur des milliers d’années. Cela assurerait au nucléaire une force certaine pour garantir l’indépendance énergétique du pays. Ces réacteurs présentent également un intérêt pour décarboner les industries lourdes, puisqu’ils produisent une chaleur à très haute température (500 °C).
C’est sur ce principe que travaille Hexana, en proposant un stockage thermique qui garantit davantage de flexibilité. « Cela permet de produire de la chaleur pour l’industrie ainsi que de l’électricité flexible sans dégrader le modèle économique du nucléaire, puisque le réacteur produit toujours en base », précise l’expert Maxence Cordiez. Une politique française d’investissements sur cette filière, comme une partie du programme France 2030 destinée à son développement – avec initialement 1 milliard d’euros fléchés vers le nucléaire –, peut ainsi répondre à ces enjeux de réindustrialisation et de souveraineté.
Des alternatives technologiques émergentes : des sels fondus à la fusion nucléaire
Des réacteurs verts et moins gourmands ?
D’autres innovations pourraient faire du nucléaire une source fiable pour contribuer à la décarbonation de nos sociétés et de nos besoins industriels. Il s’agit par exemple des réacteurs à sels fondus. Ces derniers sont particulièrement envisagés pour exploiter le thorium, un élément chimique davantage présent que l’uranium dans la croûte terrestre, bien qu’ils puissent également fonctionner avec un cycle uranium-plutonium. Ces réacteurs sont également prisés car ils produisent moins de déchets radioactifs, comme l’explique l’AIEA dans son article sur le sujet.
La Chine a octroyé un permis d’exploitation à un premier réacteur de ce type en 2023. L’Inde pourrait être l’un des pays qui en bénéficierait le plus pour réduire son empreinte carbone sur le long terme, grâce également à d’importantes réserves de thorium dans son sous-sol. Cela permettrait au pays de s’affranchir également des contraintes de l’achat d’uranium à des pays tiers, alors qu’il a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire.
L’espoir d’une énergie infinie : la fusion nucléaire
En parallèle, des travaux sont menés sur la fusion nucléaire pour parvenir à reproduire une énergie comparable à celle produite par le soleil. La fusion nucléaire, si elle est maîtrisée, offrirait à nos sociétés une énergie quasi illimitée et bas carbone. Sa maîtrise est cependant difficile et requiert de longs travaux de recherche. Pour y parvenir, 33 pays (depuis le départ temporaire de la Suisse notamment) collaborent en ce sens au sein de l’AIEA. Cela se matérialise avec le projet Iter, basé dans le sud de la France, au lieu-dit Cadarache de Saint-Paul-lez-Durance.
Un début d’exploitation du tokamak d’Iter est actuellement envisagé à partir de 2034, mais sa commercialisation pour alimenter les systèmes énergétiques ne devrait pas intervenir avant… 2075. Bien que très prometteur, son usage apparaît donc aujourd’hui trop tardif pour permettre d’atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Conclusion : le nucléaire est encore un secteur d’innovation
Le nouveau nucléaire est un secteur plein de promesses. Il pourrait offrir davantage de flexibilité, des solutions de stockage, des ressources moins contraignantes avec moins de déchets et un cycle fermé du combustible.
Mais ces nouvelles exploitations envisagées pour le nucléaire nécessitent donc de lourds investissements. Il lui faudra aussi du temps, beaucoup de temps parfois pour réussir à se développer et à se faire une place dans un système énergétique déjà bien fourni.
Enfin, il aura besoin de débouchés pour sa production électrique, à un prix compétitif – pour sa rentabilité comme pour les consommateurs, ou par rapport aux autres sources de production. Tous ces éléments peuvent rendre l’idée d’un nouveau nucléaire comme socle de la production d’électricité assez fragile, en 2025.
Avec des atouts à défendre
Cependant, ces potentiels réacteurs ont chacun des atouts à défendre. L’EPR (et l’EPR2) est un très bon moyen de fabriquer de l’électricité stable et prédictible, dans un contexte de demande facilement identifiable, bien que ce modèle soit concurrencé et affaibli par des ENR qui apportent régulièrement de l’électricité à très bon marché, par l’émergence de l’autoconsommation qui réduit la demande sur le réseau électrique général, etc.
C’est en grande partie ce modèle qui a été choisi par les pays qui souhaitent relancer la filière du nucléaire dès maintenant, avec des réacteurs de grande puissance. Dans le même temps, ces pays pourraient s’appuyer sur des réacteurs plus modulaires, compacts, avec un usage précis. C’est le cas des SMR, qui ont un rôle à jouer dans un système qui aura besoin d’un maillage fin et précis pour aligner offre et demande.
Mais qui cherche son modèle économique ?
Mais il reste un nœud à démêler : comment imaginer et rendre rentables ces différentes possibilités du nucléaire ? Dans quel mix énergétique pour 2050 et au-delà peuvent-ils se développer, tout en maintenant cette garantie essentielle d’une électrification des usages intéressante, accessible et même rentable pour les industriels, les particuliers, les entreprises du tertiaire ?
Le modèle économique du futur nucléaire est dépendant du besoin d’un signal prix favorable à la consommation d’électricité (ou de chaleur décarbonée) pour être au service de la décarbonation. Il doit donc être à la fois bon marché… et rentable.
[Le dernier article de ce dossier abordera la question des coûts et du financement du nucléaire.]

Article rédigé par Côme Tessier
Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.